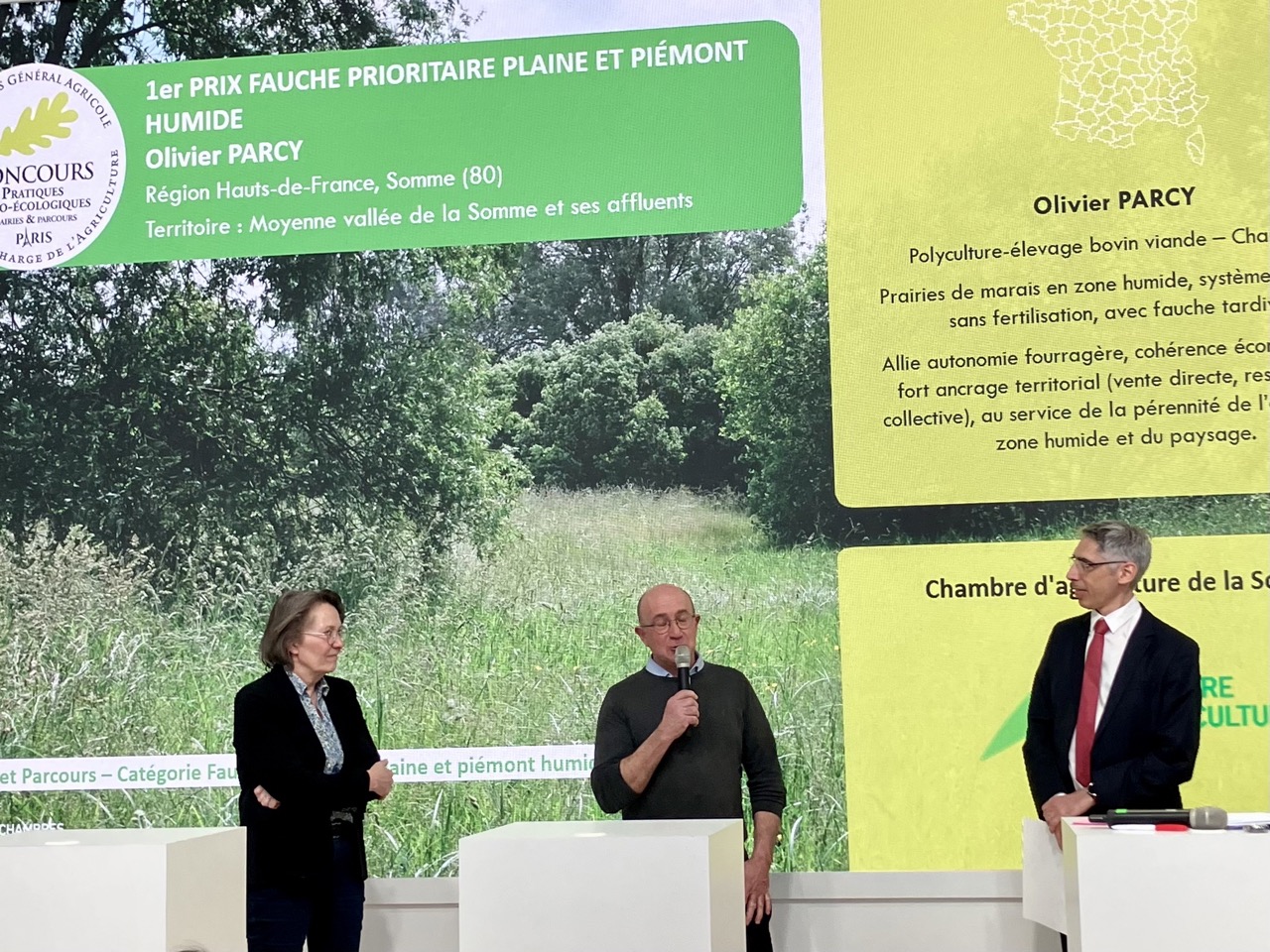Quelle évolution de l’agriculture périurbaine face aux enjeux fonciers ?
Le regard des citadins sur l’agriculture périurbaine est en général positif.

L’essor de l’agriculture de proximité est vu comme un rempart contre l’artificialisation du foncier particulièrement forte aux abords des villes. Si cela permet de maintenir une activité agricole menacée près des centres urbains, les tensions liées au foncier traduisent aussi des représentations sociales qui peuvent impacter l’agriculture de demain. S’appuyant sur les contestations de permis de construire en Ile-de-France, André Torre, directeur de recherche à l’Inra, lève des interrogations qui peuvent également s’appliquer aux autres régions fortement urbanisées.
L’activité agricole, rarement objet de conflit
Ces dernières années, le maintien de l’agriculture est une préoccupation croissante des collectivités, qui en font un objectif à part entière dans les plans d’urbanisme locaux ou régionaux (PLU, SCOT…). Parallèlement au développement des circuits courts qui facilitent le dialogue direct entre producteurs et consommateurs, cette tendance participe «à la réévaluation de l’agriculture dans notre société», note André Torre. L’agriculture revient ainsi avec force dans les représentations symboliques des urbains, avec une connotation plutôt positive. Et si l’idée est souvent véhiculée d’une difficile cohabitation entre l’agriculture et les autres activités en zone périurbaine, l’activité agricole est rarement un objet de conflit en tant que tel. Certes, les citadins émettent des inquiétudes vis-à-vis de pratiques qu’ils considèrent comme pouvant nuire à leur environnement (construction de hangar, épandage de pesticides, brûlage en plein champ…), mais en Ile-de-France, la majorité des conflits porte sur la reconversion des terres agricoles. 49 % du contentieux de la région concerne la lutte contre l’extension de la ville et de ses infrastructures au détriment des terres agricoles.
Indifférenciation entre nature et agriculture
Face à cela, 34 % du contentieux témoigne d’un mouvement parallèle de résistance contre la protection réglementaire du foncier agricole. Et ce conflit sur l’usage des terres ne se réduit pas, comme on a tendance à le croire, à une opposition entre agriculteurs désireux de préserver leur activité et urbains consommateurs de sols. Pour l’agriculteur, la question se pose aussi de maintenir une activité agricole en zone périurbaine alors que la rentabilité de la conversion des terres en terrains à bâtir est bien plus élevée, ou qu’une délocalisation permettrait de diminuer les coûts de production. L’incertitude toujours présente quant au devenir de ces terrains rend l’installation et l’extension difficile pour les agriculteurs à proximité des villes.
D’un autre côté, l’agriculture de proximité demeure prisée par les urbains qui apprécient son aspect écologique (moins de transport) et la possibilité de pouvoir contrôler l’origine des produits. Cependant, si les citadins se sont attachés à l’agriculture de proximité, c’est principalement pour «ses vertus paysagères ou de protection de l’environnement» précise encore André Torre. C’est l’«opportunité de résistance contre l’avancée du front urbain» qui les fait s’engager en faveur de l’agriculture, «source de plaisirs visuels qui rejoint leur désir de nature». La fonction principale de l’agriculture, nourrir les hommes, leur apparait d’autant plus secondaire que les circuits courts ne contribuent pas de manière significative à la fonction alimentaire des métropoles. Défendant davantage un élément de confort plutôt qu’une activité productive, les urbains se mobilisent davantage pour les activités agricoles diversifiées, biologiques, et «propres», au détriment des grandes cultures qui reculent devant la progression de l’urbanisation. Avec pour conséquence prévisible, le repli de celles-ci sur des terres moins propices à cette activité, entraînant une perte qualitative et quantitative. Car il ne faut pas oublier cette donnée de plus en plus négligée : historiquement, le développement des métropoles est souvent lié à la proximité de terres agricoles fertiles.