Paratuberculose des bovins : ce que l’on sait
A l’invitation du GDS de la Somme, Eric Meens, vétérinaire au GDMA (GDS) de Seine-Maritime, a fait partager son expérience et les nouvelles connaissances acquises sur cette pathologie majeure.
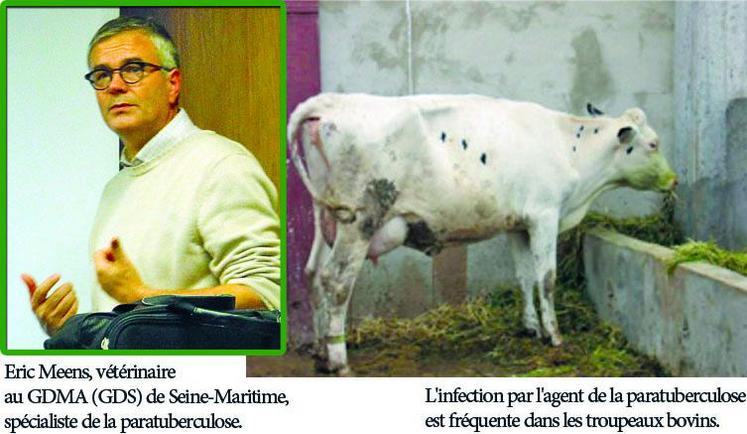
La paratuberculose est sans doute la maladie d’élevage la plus pénalisante qui soit au plan économique. Evoluant de manière lente et insidieuse, elle se traduit par la perte prématurée de vaches au terme d’une entérite profuse avec amaigrissement important qui se déclenche souvent au moment du vêlage. Les animaux exprimant des symptômes ne représentent toutefois, a précisé d’emblée l’intervenant, que la partie émergée de l’iceberg.
Ces malades (en moyenne 2-3 % de l’effectif adulte) sont suivies d’une cohorte de vaches qui «bricolent» (10 %) et d’un nombre important d’infectées latentes (60 %), dont certaines s’en tireront et d’autres rejoindront plus ou moins vite les deux groupes précédents. Après infection d’un troupeau, la chronicité s’installe, avec des années plus ou moins mauvaises, au gré de facteurs favorisants (alimentation, parasitisme, autres maladies…). Plusieurs études pointent une perte moyenne de lait de 1,5 à 2 litres par vache et par jour.
Le germe responsable est une mycobactérie de la famille des bacilles tuberculeux aviaires, qui colonise la paroi intestinale, entraînant une inflammation chronique (par réaction immunitaire exagérée) et une mauvaise absorption des aliments conduisant à la cachexie (perte d’état, fonte des muscles). Mycobacterium Avium Paratuberculosis (MAP) se transmet essentiellement par voie orale des adultes aux veaux, à partir des matières fécales des sujets excréteurs et montre une résistance extrême dans l’environnement (jusqu’à un an et plus en milieu humide et à l’abri de la lumière).
La paratuberculose est présente dans le monde entier, le taux de cheptels infectés se situant selon les études et les pays entre 50 et 90 %. Eric Meens a suggéré, par ailleurs, un lien zoonotique possible (de plus en plus probable selon des données récentes) avec la maladie de Crohne, entérite inflammatoire humaine invalidante dont le traitement est très lourd, ainsi que d’autres affections à composante immunitaire (Parkinson, sclérose en plaque…).
Comment repérer la paratuberculose
S’inspirant d’études nord-américaines, le Dr Meens a contribué à vulgariser (dans le cadre d’expérimentations menées avec les GDS du Nord et du Grand-Ouest) la notion de vaches super-excrétrices (SE) du bacille MAP. Il a montré que ces vaches pouvaient être repérées de façon fiable et peu onéreuse au moyen de la sérologie (prise de sang), celles-ci exprimant un résultat noté +++. Il a précisé qu’une vache SE dispersait plusieurs milliards de germes par gramme de fèces, et que la plupart d’entre elles présentaient des signes de la maladie ou n’en étaient pas loin.
L’intervenant a montré l’intérêt des analyses de troupeau collectives qui sont des critères d’alerte (résultat positif) ou de garantie relative (résultat négatif), surtout en répétition. Ainsi, certains GDS effectuent des tests réguliers sur le lait de tank (en projet dans la région). En Normandie, ceux-ci permettent de «pêcher» autour de 30 à 35 % d’élevages réagissant, mais il convient selon lui de multiplier par deux cette estimation, car le filet (aux mailles trop larges) ne retient que les plus contaminés. Dans les plans individuels des GDS, la problématique est comparable, on ne retient avec la sérologie que les «gros grumeaux». Ainsi, pour chaque vache séropositive, on doit considérer que les infectées (latentes sans signe pour la plupart) sont sept fois plus nombreuses !
Une maladie qui s’achète
L’introduction d’animaux est souvent à l’origine de la contamination du troupeau. Là encore, il est courant de passer à côté : les bovins porteurs de moins de deux ans ne sont pas détectables (la bactérie est en «veille») et les autres ne le sont qu’à hauteur de 15 % en moyenne par la seule prise de sang. Pour augmenter ses chances, il faut en plus une recherche fécale par PCR (on arrive ainsi à 50 % de détection) et, mieux encore, une garantie du cheptel d’origine, avec, par exemple, deux analyses de tank et une analyse d’environnement négatives (on est alors à 99 %). Enfin, la maladie tend à se développer avec les regroupements et la taille croissante des troupeaux.
La maîtrise de la paratuberculose s’appuie sur trois volets : les mesures d’hygiène (en particulier autour du vêlage et de l’élevage des veaux), le dépistage et la réforme des vaches positives (rapide pour les SE) et, enfin, un volet immunitaire et nutritionnel. Le spécialiste a développé plus particulièrement ce troisième volet. Les recherches récentes ont montré l’importance du calcium pour l’immunité dans la période du tarissement et d’une BACA (balance anions/cations) négative, préservant cet élément. Il y a des aliments à privilégier et d’autres à éviter (aliments riches en potassium : drèches, luzerne, herbe…) ; la distribution de chlorure de magnésium peut être utile. Le rapport d’acides gras oméga 3/oméga 6 constitue également un levier sur la prévention, en favorisant les premiers, qui sont de nature à limiter les réactions inflammatoires (immunité non productive).
Cette piste ressort d’observations dans des élevages laitiers engagés (pour influer sur la composition du lait) dans une démarche de complémentation en tourteau de lin. Eric Meens a indiqué que des travaux en cours étaient prometteurs. Plus généralement, a-t-il conclu, quand on lutte contre la paratuberculose sur ces aspects, on réduit concomitamment d’autres pathologies (métrites, non délivrances, déplacements de caillette…). Enfin, il a évoqué d’autres voies à explorer comme la diminution des habitudes de léchage de l’environnement (murs, tubes, matériel) observées chez les veaux laitiers : l’utilisation de seaux-tétines permettrait de réduire ces comportements, et donc les contaminations.
La vaccination est à nouveau possible avec un vaccin tué (Silirum), mais doit être raisonnée au cas par cas. En effet, d’une efficacité somme toute limitée (ferait moins bien que l’ancien vaccin vivant Néoparasec), il rend impossible tout dépistage ultérieur par sérologie (le vaccin «marque» les animaux) et complique les expertises en cas de risque tuberculose. La génomique, a conclu Eric Meens, pourrait constituer un outil de premier choix, mais les explorations (en cours) vont demander du temps et des moyens.











