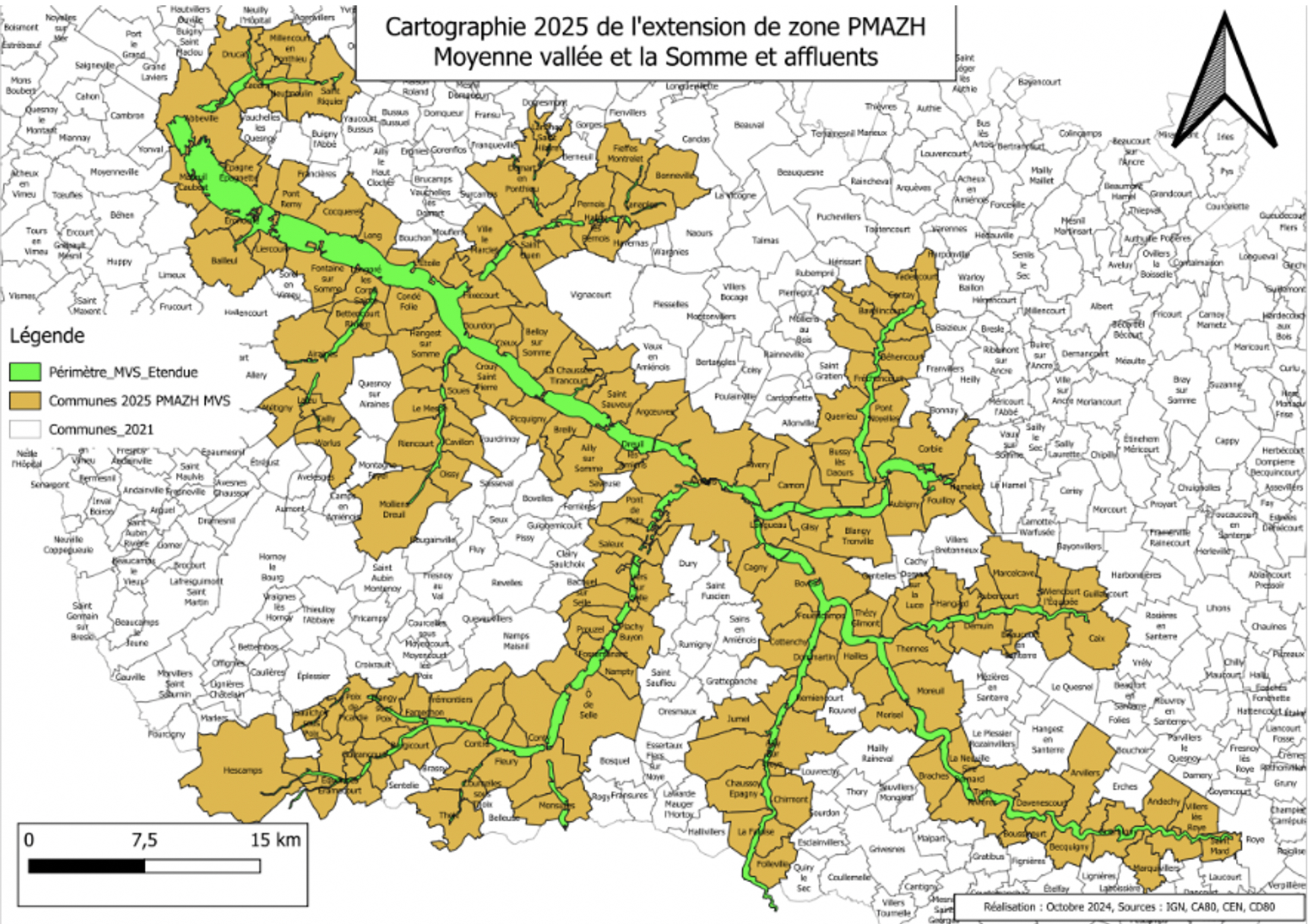Installation
Pour les agricultrices, la reconnaissance est encore un défi à relever
Aujourd’hui encore, les femmes rencontrent plus de difficultés que les hommes à s’installer, puis à être reconnues en tant que cheffe d’exploitation agricole. Le PAIT Hauts-de-France (Point accueil installation-transmission) organisait une journée sur le sujet de la place des femmes en agriculture, le 13 mars à Estrée-les-Crécy.
Aujourd’hui encore, les femmes rencontrent plus de difficultés que les hommes à s’installer, puis à être reconnues en tant que cheffe d’exploitation agricole. Le PAIT Hauts-de-France (Point accueil installation-transmission) organisait une journée sur le sujet de la place des femmes en agriculture, le 13 mars à Estrée-les-Crécy.

«Nous, les femmes, avons toute notre place dans le milieu agricole. Mais nous devons déployer encore plus d’énergie qu’un homme, car il nous faut prouver que nous sommes légitimes.» C’est le constat que dresse Laëtitia Brayelle, maraîchère de Boisleux-Saint-Marc (62). Ce 13 mars, elle témoignait aux côtés de trois autres agricultrices lors d’une journée des partenaires du PAIT (Point accueil installation-transmission) sur le thème de la place des femmes en agriculture. Toutes font le même constat : être cheffe d’exploitation est évidemment possible, mais il faut faire ses preuves, encore plus qu’un homme.
Pour Camille Steil, hélicicultrice à Drucat, en Baie de Somme, le plus difficile a été l’installation. «J’aurais voulu m’installer et 2018, mais j’ai dû repousser à 2019 car j’étais enceinte. J’allais présenter mon projet atypique à la banque, avec mon gros ventre… Autant dire que les conseillers bancaires étaient frileux.» La solidité de son dossier a fini par payer. «Il faut croire en son projet, et être encore plus carré qu’il ne le faudrait. Il n’y a pas de faille possible», témoigne-t-elle.
Pour Alexandra Cannesson, l’installation était, sur le papier, plus facile, puisqu’elle s’associait avec son mari déjà agriculteur, à Estrée-les-Crécy. «Il a quand même fallu que je me fasse mon trou. Ma principale tâche est la gestion administrative de la ferme, mais je voulais aussi avoir mon activité à moi. J’ai créé un atelier de production et vente de plantes aromatiques. Il a fallu que je démontre qu’il avait toute sa place à la ferme.»
Mathilde Saillart s’est, elle, associée à son frère, en reprenant la ferme de polyculture-élevage allaitant familiale d’Hémévillers (60). «Je suis issue d’une famille de cinq enfants – deux frères et trois sœurs – et pour mes parents, la question ne s’est jamais posée. Il n’y avait pas de place pour les filles à la ferme.» Au décès de son papa, elle prend le relais de l’élevage, sa passion, et fini par en faire son métier. «Ma mère ne l’a toujours pas accepté. Pourtant, je sais que j’y suis à ma place. Mon frère préfère être en plaine. Chacun a son poste et on se complète parfaitement.»
Comment viennent-elles à bout des lourdes tâches ? «On développe des capacités d’adaptation, pour protéger son corps et sa tête», explique Laëtitia Brayelle. Elle fait par exemple concevoir un système d’enroulage-déroulage des bâches de maraîchage, lourdes à tirer. Mathilde Saillart a fait équiper son tracteur d’un système d’attelage automatique. «Mon frère se moquait en me disant que c’était un truc de feignant. Il a finalement fait équiper tous les tracteurs de la ferme», rit-elle. Laëtitia ajoute : «Réduire la pénibilité physique n’est pas qu’un truc de femme. Chacun doit savoir s’économiser pour tenir dans la durée.»
Un réseau féminin en circuits courts
Toutes ont enfin relevé l’importance du réseau pour se faire accompagner. Dans ce cadre, la Chambre d’agriculture de la Somme a créé en février 2024 un réseau féminin, constitué d’une dizaine d’agricultrices qui commercialisent leurs produits en circuits courts. «Il y a un besoin d’échanges directs, pour lutter contre l’isolement et aborder des sujets tels que l’organisation du travail, l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle…», présente Marine Delignières, conseillère en filières courtes. Des rendez-vous sont donnés tous les deux mois, avec l’intervention d’un expert sur le sujet choisi. «On se crée des collègues. Se sentir soutenue est une motivation au quotidien», affirme Camille Steil, qui fait partie du groupe. Les portes sont ouvertes aux nouvelles venues.
Quelques avancées majeures
L'histoire des droits des femmes en agriculture a été marquée par plusieurs avancées importantes au fil des années. Voici quelques dates clés qui ont contribué à la reconnaissance des droits des femmes dans le secteur agricole en France :
- 1976 : les agricultrices demandent à être reconnues et à avoir un statut
- 1980 : loi instaurant un mandat réciproque entre époux qui exploiteraient une même exploitation. La conjointe du chef d'exploitation obtient des droits dans la gestion de l'exploitation.
- 1982 : avec la loi du 10 juillet, les conjoints d'agriculteur peuvent devenir associés à part entière. Ils peuvent acquérir un statut de chef d'exploitation au même titre que leur mari, notamment dans les Gaec.
- 1985 : la loi d'orientation agricole crée l'exploitation agricole à responsabilité limité (EARL) qui offre la possibilité aux époux de constituer une société. La femme dispose des mêmes droits que l'homme. Avec la loi réformant les régimes matrimoniaux, la notion de chef de famille disparaît.
- 1999 : la loi d'orientation agricole crée le statut social de conjoint collaborateur. Il ouvre droit à la retraite pour le conjoint ainsi qu'à des prestations sociales en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles et à une créance de salaire différé en cas de décès de l'époux et de divorce.
- 2006 : la loi d'orientation agricole ouvre le statut de conjoint collaborateur aux personnes pacsées ou aux concubins. Elle supprime l'accord du chef d'exploitation pour avoir accès au statut de conjoint collaborateur. Le conjoint du chef d'exploitation exerçant une activité régulière devra opter pour l'un des statuts suivants : collaborateur, salarié ou chef d'exploitation).
- 2010 : la loi de modernisation agricole ouvre la possibilité de constituer un Gaec entre époux seuls.
- 2015 : application du principe de transparence aux Gaec qui permet de reconnaître l'activité des hommes et des femmes au sein de l'exploitation.
Source : document de présentation de la Commission nationale des agricultrices de la FNSEA
Un groupe de travail national pour les femmes en agriculture
À l’occasion de la journée des Droits des femmes, le 8 mars, la ministre de l’Agriculture Annie Genevard a mis en place un groupe de travail dédié à la place des femmes en agriculture. Composée d’une douzaine d’agricultrices, de chercheuses, de syndicalistes* etc., il aura pour tâche de travailler sur les obstacles qui freinent les femmes : stages, accès au foncier, garanties bancaires, formation, suivi médical. La ministre souhaite donner plus de visibilité à celles qui dirigent le quart des exploitations agricoles. Annie Genevard n’a pas caché «son admiration pour la détermination de ces femmes qui parfois s’oublient par devoir et générosité». La ministre souhaite aussi sensibiliser les jeunes femmes aux métiers du vivant «car elles ont un rôle à jouer dans le renouvellement des générations». Dans la foulée, Annie Genevard a inauguré une exposition de photographies de femmes du monde agricole. Des portraits en noir et blanc, où l’on croise une fromagère, une maréchale ferrante et des éleveuses de toutes catégories d’animaux. Des clichés étonnants de vie, présentés et prêtés par le comice agricole de Besançon qui attire des milliers de personnes. Un «vache de salon» dit-on car la race Montbéliarde y est reine.
(*) Y siège notamment Catherine Faivre-Pierret, président de la Commission nationale des agricultrices de la FNSEA