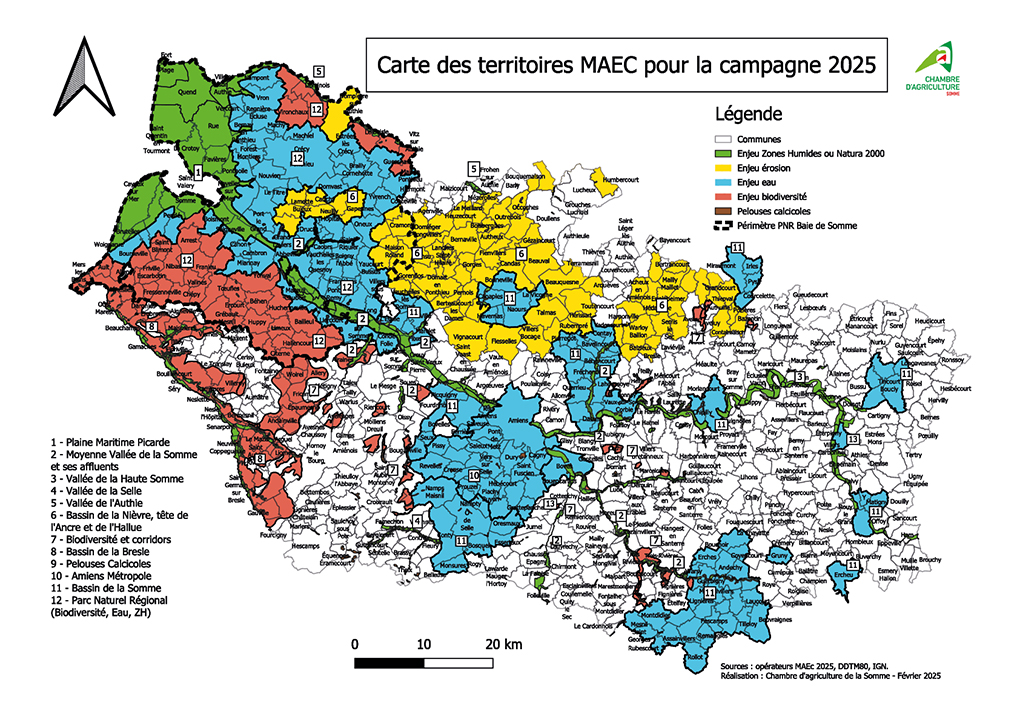Diversification
Les fraises de la cueillette d’Airaines s’arrachent comme des petits pains
À Airaines, au sud-ouest d’Amiens, la famille Legry termine sa deuxième saison de fraises, avec un succès grandissant. Cette diversification, bien que chronophage, offre un revenu supplémentaire à la ferme céréalière, et un contact avec les locaux qu’ils dégustent.
À Airaines, au sud-ouest d’Amiens, la famille Legry termine sa deuxième saison de fraises, avec un succès grandissant. Cette diversification, bien que chronophage, offre un revenu supplémentaire à la ferme céréalière, et un contact avec les locaux qu’ils dégustent.


La fraise est un des fruits préférés des Français. Ce fait se confirme à Airaines. Bien que quinze jours plus tardive qu’en 2022, à cause de la météo fraîche en début de printemps, la deuxième saison de la cueillette d’Airaines est un vrai succès. «Le projet est né pendant le confinement. J’avais envie de me diversifier, et je cherchais une autre manière d’exploiter une parcelle située entre notre maison et des habitations voisines. Les fraises ont séduit toute la famille», explique Benjamin Legry, à la tête de l’EARL des Canadiens.
Le polyculteur disposait d’un assolement déjà diversifié, avec 180 ha de céréales, betteraves, lin, colza, pois protéagineux et graminées porte-graines. Les fraises paraissaient une activité cohérente. «La récolte, en mai, est une période calme pour les autres productions.» Avec son épouse Ariane (enseignante et salariée à temps partiel de l’exploitation) et leurs enfants, Marceau, Achille et Ferdinand, ils ont mis la main à la patte dès avril 2021. «Nous avons bénéficié de quelques conseils techniques du spécialiste Pépimat, à Noyon (60). Mais nous nous sommes beaucoup débrouillés seuls», se souvient Ariane.
16 500 pieds ont été plantés en pleine terre dans la parcelle de 4 000 m2. «Le hors sol représentait un investissement trop important», justifie Benjamin. 10 000 € ont tout de même été nécessaires pour l’achat des plants, du matériel d’irrigation, des bâches et d’un tunnel qui permet d’avancer le début de la récolte de quelques jours. Pour préparer les buttes avant plantation et dérouler le plastique, du matériel leur a été mis à disposition par un producteur de Crécy-en-Ponthieu. Trois variétés ont d’abord été choisies «pour répartir le risque» :
la Darselect, longue et conique à la chair ferme très gustative, la Deluxe, rustique qui tolère bien le froid et les maladies, et la Daroyale, très précoce. Cette année, la Cirafine, variété remontante, permet de prolonger la saison jusqu’à l’automne. Les pieds produiront pendant trois ans, puis devront être remplacés. «Nous prévoyons une rotation, à hauteur d’un tiers par an.»
Aujourd’hui, la production est à la hauteur des attentes. Les plants, qui ont tous repris, s’en donnent à cœur joie. «C’est peut-être même trop. En théorie, un pied doit donner 500 grammes de fraises. On n’avait pas estimé le travail que représenterait le ramassage manuel de plus de 8 000 kg», en rit Ariane. Avec ses fils, il lui arrive régulièrement d’aller cueillir très tôt le matin, avant de partir pour l’école et le collège. Cette année, une saisonnière, à hauteur de douze heures par semaine, est venue leur prêter main forte. Benjamin dépense aussi beaucoup d’énergie pour maintenir la parcelle propre. «Les fraisiers, c’est du chiendent. Une fois que c’est bien implanté ça prend vite beaucoup d’ampleur. J’y vais carrément à la débroussailleuse.» Il faut également aérer les pieds, les éclaircir, et arracher les chardons. «Cela représente au moins quinze jours de travail.»
La récompense des bons retours
Au-delà de la charge de travail, la famille s’épanouit dans cette nouvelle activité. «Les gens en redemandent. Tout ce qui est ramassé est vendu. Nous privilégions la qualité, et nous avons d’excellents retours. C’est très gratifiant», acquiesce le couple. Pour la commercialisation, qu’ils voulaient en direct pour maîtriser la marge, Benjamin et Ariane ont fait le choix du distributeur automatique, installé à une petite centaine de mètres de la ferme. «On le remplit tous les matins, et les soixante barquettes soit 30 kg, affichées à 9 €/kg, partent le jour-même. Le week-end, on réapprovisionne même dans la journée.» Les fraises représentent désormais 5 % du chiffre d’affaires de l’exploitation.
Pour compléter, pendant la pleine saison, Ariane a ouvert une cueillette les mercredis et samedis matins. «Ça permet des échanges directs. On touche une autre forme de clientèle, dont des familles et des personnes âgées, qui prennent le temps de cueillir. Ça nous aide dans ce travail de cueillette aussi», témoigne Ariane. Les locaux y découvrent alors les services que l’agriculture rend à l’environnement. Les abeilles des ruchers des Avettes de Melllonia, à Saleux, de Frédéric Cuissette, y butinent d’ailleurs joyeusement.
Les fraises d’Airaines sont également mises en valeur par des artisans du coin, avec les tartes aux fraises du Fournil de la vallée, boulangerie de la commune, et les desserts du restaurant La Claire Fontaine, à Fontaine-le-Sec. Un petit fruit rouge qui véhicule une image positive des agriculteurs locaux.
La framboise française, un marché à potentiel

À côté des fraisiers de la cueillette d’Airaines s’épanouit une haie, elle aussi productive. Il s’agit de framboisiers, qui regorgent de fruits en ce début d’été. «Les framboises diversifient un peu notre offre. Il y a une demande des clients», assure Ariane Legry. Les barquettes de framboises placées dans le distributeur automatique ont autant de succès que celles de fraises. Pour l’AOPn Fraises de France, ce fruit rouge présente un potentiel certain. «En ce début du mois de juillet, tous les bassins de production de framboises sont désormais actifs. Les volumes s’intensifient et gonflent davantage encore les rayons des GMS en origine France», note Émeline Vanespen, sa directrice, dans un communiqué. Mais la framboise française rencontre quelques difficultés : «elle fait face à l’importation en grande distribution, qui concurrence notre origine». Le taux de consommation de l’origine France n’atteint que 15 %. 85 % des framboises consommées en France proviennent donc de l’étranger. La raison évoquée par les GMS ? À l’image de la fraise, la framboise est une culture très sensible à la météo, qui peut connaître des à-coups de production comme des creux. L’importation permet donc de sécuriser l’approvisionnement. Pourtant, avec une demande qui s’intensifie d’année en année, le marché est en plein développement. Une opportunité pour d’éventuels nouveaux producteurs. «Plus la production augmentera, plus on aura de chance d’asseoir le produit français en GMS en conservant les lignes.» Les Legry, eux, se sont affranchis de cette contrainte avec la vente directe.